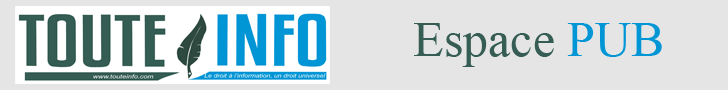Tribune : La Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples face au défi de la souveraineté des Etats (Nouhou Madani Diallo)
samedi 18 juillet 2020

La Souveraineté, « c’est un écran qui voile la réalité, il faut s’en débarrasser si l’on veut voir clair » (N. POLITIS in Les limitations de la souveraineté, page 10) « L’homme de bien situe la justice au – dessus de tout. » Confucius
I. Introduction
Créée par le Protocole dit de Ouagadougou adopté le 09 juin 1998 pour compléter « les fonctions de protection de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples a conférées à la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples » , la Cour africaine des droits de l’Homme et des Peuples est le seul organe dont la vocation est la protection juridictionnelle des droits de l’Homme en Afrique.
Elle est composée de onze (11) juges ressortissants des Etats membres de l’UA élus, à titre personnel, par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement pour un mandat de six ans renouvelable une fois. L’attribution des sièges est tributaire d’une représentation géographique équilibrée, Chaque région du continent (Est – Ouest – Centre – Nord et Sud) disposant de deux (2) sièges, occupés nécessairement par un homme et une femme , en plus d’un siège flottant qui revient, en alternance, à chaque région .
Aux termes de L’article 3 du Protocole, “La Cour a compétence pour connaitre de toutes les affaires et de tous les différents dont elle est saisie concernant l’interprétation et l’application de la Charte, du Protocole et de tout autre instrument, pertinent relative aux droits de l’Homme et ratifié par les Etats concernés…”.
Cette disposition atteste, si besoin en est, d’une première particularité du système africain des droits de l’Homme. En effet, à la différence de ses précurseurs que sont de la Cour européenne des droits de l’Homme devant laquelle seules les violation de la Convention de sauvegarde et des libertés fondamentales de 1950 peuvent être invoquées et de la Cour Interaméricaine des droits de l’Homme où seule la Convention interaméricaine des droits de l’Homme de 1969 est applicable, la Cour africaine peut interpréter et appliquer non seulement la Charte africaine des droits de l’Homme et son Protocole fondateur mais encore tout instrument international de droits de l’Homme ratifié par l’Etat en cause.
Le Protocole est entré en vigueur le 25 juin 2004 après quinze (15) ratifications. Les premiers juges ont été élus en 2006, année à laquelle la Cour a commencé ses activités à Addis-Abeba. Depuis 2007, son siège est à Arusha, en République Unie de Tanzanie, d’où elle exerce, depuis lors, sa jurisdictio (I). En février 2016, puis récemment en novembre 2019 et en avril 2020, elle fait face à une vague de retraits des déclarations d’acceptations facultatives de juridiction obligatoire (II).
I. La jurisdictio de la Cour africaine
C’est le propre de toute Cour de ne pouvoir s’auto – saisir. Aussi, en plus d’avoir déterminé la compétence ratione materiae de la Cour au travers de ses articles 3 et 7, le Protocole en a t – il réglementé les modes de saisine (A) qui lui ont permis d’élaborer sa jurisprudence (B)
A. Modes de saisine de la Cour
Dans l’exercice de sa compétence contentieuse, l’article 5 (1) du Protocole est le siège des modes de saisine de la Cour. Au sens de ce texte, elle peut être saisie par a) la Commission ; b) l’État partie qui a déposé une plainte auprès de la Commission ; c) l’État partie contre lequel une plainte a été déposée auprès de la Commission ; d) l’État partie dont un citoyen est victime d’une violation des droits de l’homme ; e) les organisations intergouvernementales africaines.
En outre, au sens de l’article 5(3), les individus et des Organisations Non Gouvernementales (ONG) ayant le statut d’observateur auprès de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples peuvent saisir la Cour conformément à l’article 34(6) du Protocole qui dispose : "Au moment de la ratification du présent Protocole ou à tout moment par la suite, l’État fait une déclaration par laquelle il accepte la compétence de la Cour pour connaître des affaires visées à l’article 5(3) du présent Protocole. La Cour ne reçoit aucune requête au titre de l’article 5(3) impliquant un État partie qui n’a pas fait cette déclaration".
II faut noter qu’à ce jour, trente (30) Etats ont ratifié le Protocole et seulement dix (10) États ont fait la déclaration en vertu de l’article 34 (6) permettant un accès direct à la Cour pour les individus et les ONG concernés.
Les requêtes déposées devant la Cour l’ont été, pour la plupart d’entre elles, par des individus et par des ONG. Au 28 avril 2020, la Cour a reçu un total de deux cent soixante-quatorze (274) requêtes dont trois (3) émanant de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, treize (13) soumises par des ONG et deux cent cinquante-huit (258) par des individus. Elle a rendu au total quatre – vingt (90) décisions dont cinq (5) suite à des requêtes aux fins de révision et quatre (4) suite à des requêtes aux fins d’interprétation.
S’agissant de la compétence consultative, les modes de saisine de la Cour sont réglementés par l’article 4 du Protocole qui permet à tout Etat membre de l’UA, tout organe de l’UA ou toute organisation africaine reconnue par l’UA de saisir la Cour d’une demande pour « avis sur toute question juridique concernant la Charte ou tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’Homme, à condition que l’objet de l’avis consultatif ne se rapporte pas à une requête pendante devant la Commission »
A ce jour, la Cour a reçu treize (13) demandes d’avis consultatif dont douze (12) ont été finalisées.
Ces chiffres relatifs aux procédures contentieuses et aux avis consultatifs suffisent à démonter le besoin réel pour les citoyens africains d’accéder à la Cour pour faire protéger leurs droits.
Cependant, depuis 2016, on constate un mouvement de retrait qui a commencé avec le Rwanda.
II. Raisons invoquées pour le retrait de déclaration
Le 29 février 2016, le Rwanda a informé le Président de la Commission de l’UA du retrait de sa déclaration faite en vertu de l’article 34(6). Récemment, entre Novembre 2019 et Avril 2020, en l’espace donc de six (6) mois, trois autres Etats, à savoir la Tanzanie, pays qui abrite le siège de la Cour, le Bénin et la Côte d’Ivoire, lui ont emboîté le pas, ouvrant ainsi la voie à toutes sortes d’interrogations sur les raisons réelles ou supposées de tels retraits.
S’agissant des raisons de ce retrait, elles divergent selon les Etats. Pour le Bénin et la Côte D’Ivoire, la Cour a porté atteinte à leur souveraineté.
Le Rwanda a estimé que “la déclaration a été exploitée et utilisée contrairement à l’esprit qui est derrière la volonté de faire cette déclaration.” Comme pour donner davantage de poids à sa décision, il a soutenu que la Cour ne doit pas être une tribune pour des personnes suspectées ou condamnés pour participation au génocide des Tutsis de 1994. De fait, c’est à l’occasion de l’examen de la Requête introduite par Ingabire Victoire Umuhoza que le Rwanda a élevé toutes ces observations sous – tendant sa décision. Dans son arrêt, la Cour a dit et jugé que le Rwanda « a violé l’article 7(1) (c) de la Charte en ce qui concerne les irrégularités de procédure ayant affecté le droit à la défense (…) et les articles 9(2) de ladite Charte et 19 du Pacte International sur les droits civils et politiques en ce qui concerne le droit à la liberté d’opinion et d’expression »
En ce qui la concerne, la République Unie de Tanzanie a considéré que la Cour a fait fi des réserves faites au moment de la déclaration sur l’article 34(6) du Protocole, ce qui est contraire à sa Constitution.
Pour sa part, invoquant une ordonnance de mesures provisoires rendue le 28 février 2020, à l’occasion d’une affaire qu’elle qualifie de « commerciale », la République du Bénin fonde sa décision sur « les égarements de la Cour (qui) sont devenus source d’une véritable insécurité juridique et judiciaire à laquelle il est de la responsabilité des gouvernants de porter remède ». Curieusement, cette décision de retrait prise le 22 avril 2020 semble davantage liée, au moins dans sa séquence temporelle, à l’ordonnance de mesures provisoires rendue cinq (5) jours auparavant dans l’affaire Sébastien Germain Ajavon c. Bénin, tant et si bien que les observateurs les plus avertis se demandent légitimement, si l’affaire de l’opposant béninois n’est pas la partie non ostensible de l’iceberg.
S’agissant de la République de Côte d’Ivoire, la décision de retrait a été motivée par l’ordonnance de mesures provisoires rendue le 22 avril 2020 en prélude à l’examen au fond de la requête introduite par l’opposant Guillaume K. Soro, potentiel candidat à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020. La Cour avait ordonné à l’Etat défendeur, entre autres, de surseoir à l’exécution du mandat d’arrêt décerné contre Guillaume K. Soro et du mandat de dépôt décerné contre dix-neuf de ses partisans et leur accorder la liberté provisoire.
Il est important de noter que pour ce qui est du Rwanda, du Bénin et de la Côte D’Ivoire, le retrait fait suite à des décisions de la Cour concernant des oppositions politiques locales.
Autre fait notable, les décisions rendues contre la République du Bénin et la République de Côte d’Ivoire sont des ordonnances de mesures provisoires qui, par nature, ne sont pas définitives et peuvent être modifiées, s’il échait.
Ces trois pays reprochent à la Cour d’avoir porté atteinte à leur souveraineté en s’immisçant dans leurs affaires intérieures. Pourtant, ils ont volontairement ratifié la Charte ainsi que le Protocole et c’est avec la même volonté aussi éclairée qu’il ont déposé leurs déclarations de reconnaissance de compétence de la Cour pour recevoir les requêtes introduites par les personnes physiques et les ONG dotées du statut d’observateur auprès de la Commission. Il est difficile de comprendre cet argument relatif à la question de la souveraineté parce – qu’en Droit International, c’est un truisme que d’affirmer que lorsqu’un Etat signe et ratifie un traité ou accepte de faire la déclaration d’acceptation de compétence contenue elle – même dans un traité, il cède de fait une partie de sa souveraineté pour un but bien précis. Dès lors, le pouvoir dont dispose la Cour n’est que l’émanation de ces ratifications et n’est exercé que dans le but conforme à l’objet du Protocole qui l’a créé, à savoir la protection juridictionnelle des droits de l’Homme. En clair, lorsque la Cour reçoit des requêtes et rend des jugements, elle met en application un mandat à lui donné par ces mêmes Etats. L’on ne peut donc vouloir d’une chose et son contraire. Avec cette réticence des Etats, l’on peut se demander ce que la Cour a pu faire à ce jour, à sa voir sa jurisprudence.
III. La jurisprudence de la Cour
Les nombreuses requêtes dont la Cour a été saisie lui ont permis de rendre des décisions sur des thèmes d’une importance capitale pour les victimes et tous les acteurs en matière des droits de l’Homme, construisant ainsi sa propre jurisprudence.
L’édifice prétorien de la Cour confirme son rôle dans la protection des droits de l’Homme dont certains ne peuvent manquer d’être cités. Il en est ainsi, notamment, du droit à participer librement à la direction des affaires publiques , du droit à un procès équitable, la liberté d’expression, le droit à l’assistance judiciaire et le droit à la défense, droits des peuples autochtones etc…A titre d’illustration, dans sa première décision au fond , la Cour s’est prononcée sur la lancinante question de l’interdiction de candidatures indépendantes en relation avec l’article 13 de la Charte qui consacre le droit de participer librement à la direction des affaires publiques de son pays. Elle a tranché que « le droit du Requérant (Rév. Christopher Mtikila) de participer librement aux affaires publiques de son pays a été violé du fait que pour se porter candidat aux élections présidentielles, législatives ou locales en Tanzanie, il faut être membre d’un parti politique. Les tanzaniens ne sont donc pas libre de participer à la direction des affaires publiques de leur pays, directement ou par le choix libre de leurs représentants » . Dans le même ordre d’idées, la Cour a considéré que « le fait que le Défendeur (République Unie de Tanzanie) exige de ses citoyens d’adhérer à un parti politique et d’être investi par celui – ci comme préalable pour se porter candidat aux élections locales, législatives ou présidentielles, constitue une entrave à la liberté d’association, puisque les individus sont contraints d’adhérer à une association ou d’en créer une, avant de pouvoir se porter candidats à des postes électifs » .
La même année que la décision sus - citée, la Cour a rendu un autre arrêt dans l’affaire Lohé Issa Konaté c. le Burkina Faso, fort remarquable pour la liberté d’expression et la liberté des journalistes. Cet arrêt consacre la dépénalisation du délit de presse tant recherché par les journalistes et les activistes de droits de l’Homme. La Cour a, en effet, considéré que les dispositions légales qui prévoient et répriment le délit de diffamation « sur la base desquelles le Requérant (le journaliste Lohé Issa Konaté) a été condamné à une peine privative de liberté ne sont pas compatibles avec l’article 9 de la Charte et 19 du PDCIP. » Dans la même veine, elle a estimé que l’Etat défendeur avait manqué à son obligation de protéger les droits des journalistes, tels que protégés par l’article 66(2) (c) du Traité révisé de la CEDEAO « dans la mesure où la peine privative de liberté prévue par les dispositions législatives (du Burkina Faso) constitue une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression des journalistes en général et du Requérant en particulier. »
Dans l’affaire dite des Ayants - droit de feus Norbert Zongo la Cour a jugé que le Burkina Faso n’avait « pas agi avec la diligence due dans la recherche, la poursuite et le jugement des responsables des assassinats de Norbert Zongo et ses trois compagnons et (…) (avait) violé, sous cet aspect les droits des requérants à ce que leur cause soit entendue par les juridictions nationales garanti par l’article de la Charte » . En conséquence, elle avait ordonné au Burkina Faso de reprendre les investigations en vue de rechercher et de poursuivre les assassins de Norbert Zongo le célèbre journaliste d’investigations retrouvé mort carbonisé avec tous ses compagnons le 13 décembre 1998 sur une route dans le sud du Burkina Faso.
En 2017, un autre arrêt de la Cour rendu contre la République du Kenya a fait jurisprudence. L’arrêt porte sur les droits de la communauté Ogiek, communauté autochtone du Kenya sur leurs terres ancestrales dans la forêt Mau . La Cour a élaboré les critères de détermination et d’identification des populations autochtones et de la compréhension de cette notion . Elle a estimé, en outre, que « le droit de propriété tel qu’il est garanti par l’article 14 (de la Charte) peut aussi s’appliquer aux groupes ou communautés », ce droit pouvant « être individuel ou collectif » La Cour a conclu « qu’en expulsant les Ogiek de leurs terres ancestrales contre leur gré, sans consultation préalable et sans respecter les conditions d’une expulsion pour cause d’utilité publique, l’Etat défendeur a violé leurs droits à la terre tels qu’ils sont définis(…) et garantis par l’article 14 de la Charte, lu à la lumière de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des Peuples autochtones de 2007 »
IV. Difficile coopération avec les Etats membres
Depuis le début de ses travaux, la Cour, a toujours eu des difficultés dans sa coopération avec les Etats membres concernant l’article 34.6 et la mise en œuvre de ses décisions. Quand elle a commencé ses travaux en 2006, seuls (vingt – quatre) 24 pays, soit moins de la moitié des pays du continent, avaient ratifié le Protocole et un seul, le Burkina Faso avait fait la déclaration reconnaissant la compétence de la Cour. Au vu de cette situation, la Cour a dû mettre en place une campagne de sensibilisation des Etats membres, qui consiste à se rendre dans différents pays, rencontrer les autorités notamment les Chefs d’Etats en vue de les encourager à ratifier le Protocole et de faire la déclaration facultative de juridiction obligatoire. Cette campagne a connu un succès relatif parce qu’après avoir visité vingt-sept (27) pays entre 2011 et 2019, la Cour n’a obtenu que six (6) ratifications et neuf (9) déclarations de plus.
Pour ce qui est de la mise en œuvre des décisions de la Cour, la situation n’est guère meilleure. Selon l’article 31 du Protocole, la Cour fait rapport à la Conférence des Chefs D’Etat et fait état des cas où un Etat n’aura pas exécuté une décision de la Cour. L’article 29 (2) du Protocole stipule « Les arrêts de la Cour sont aussi notifiés au Conseil Exécutif qui veille à leur exécution. » En clair, la responsabilité de l’exécution des arrêts de la Cour revient au Conseil Exécutif de l’Union Africaine. A ce jour, sur les quatre-vingt-dix (90) décisions rendues contre des Etats membres, seules deux décisions ont été pleinement mises en œuvre par l’Etat concerné, le Burkina Faso. Dans ses différents rapports à la Conférence des Chefs d’Etats, la Cour a recommandé aux Etats membres d’envisager une réforme par rapport à l’article 34.6 portant sur la déclaration parce qu’il constitue un obstacle à l’accès à la Cour, cette recommandation n’a pas été suivie d’effet.
Il faut dire que dès le début, la mise en place de cette Cour a rencontré beaucoup d’obstacles politiques de la part de certains Etats qui étaient réticents à l’idée d’une Cour supra nationale. Mais face aux efforts des organisations de la société civile africaine et Internationale, elle a pu voir le jour.
Le fait que plus de vingt (20) ans après l’adoption du Protocole, seuls trente (30) Etats l’ont ratifié et dix (10) ont fait la déclaration d’acceptation de compétence, est une preuve que la réticence persiste encore.
Cependant, il est important de noter que la Cour n’est ni la première ni la seule à connaitre un tel rejet de la part des Etats dès que les décisions portent sur les droits de l’Homme. La Cour de la CEDEAO, la Cour de la Communauté de l’Afrique de l’Est et la Cour de la SADEC, connaissent le même sort, leurs décisions n’étant pas toujours respectées. Les Etats membres leur reprochent de porter atteinte à leur souveraineté. En ce qui concerne par exemple, le Tribunal de la Communauté de développement de l’Afrique australe (Tribunal de la SADEC), ses activités ont été suspendues avant sa dissolution, après qu’elle eut rendu une décision contre le Zimbabwe, lui ordonnant de protéger les droits de propriété des terres des demandeurs Le Zimbabwe avait refusé d’exécuter ladite décision.
V. Faut-il réformer la Cour Africaine ?
Au vu de la situation actuelle, avec le désaveu de certains Etats, c’est peu de dire que la Cour est à la croisée des chemins. Est – elle incomprise ?
Il serait souhaitable que l’Union Africaine engage avec les Etats membres une discussion franche pour déterminer leur réelle volonté et permettre à la Cour de poursuivre la mission qui lui a été assignée par le Protocole Il est légitime de s’interroger sur la manière dont une Cour dont la compétence pour recevoir les requêtes émanant des individus et des ONG ayant le statut d’observateur auprès de la Commission n’est reconnue maintenant que par six (6) Etats , sur (cinquante – cinq) 55 peut-elle mener à bien son mandat qui est d’assurer la protection juridictionnelle des droits de l’Homme sur le continent ? Il faut ajouter à cela que 75% des plaintes visent la Tanzanie le pays hôte qui a aussi retiré sa déclaration. Que vaut une Cour dont les décisions sont bafouées, totalement ignorées ?
L’Union Africaine peut envisager des réformes portant sur l’article 34.6 du Protocole, la responsabilité de la mise en œuvre des arrêts de la Cour et le fonctionnement de la Cour, en temps plein et en créant par exemple une chambre d’Appel – composée de cinq (5) juges et de deux chambres de première instance, composée chacune de trois (3) juges, ce qui fait un total de onze (11) . Une autre option serait de faire comme la Cour de la CEDEAO, en réduisant le nombre de juges à cause du coût financier, mais qu’ils soient en temps plein résident au siège de la Cour. L’expérience a prouvé qu’il est plus facile pour les juges de travailler sur place que quand ils sont de retour dans leurs pays d’origine, où ils ont d’autres occupations.
Les populations africaines tout comme les autres populations du monde, ont des droits inaliénables qui doivent être protégés et c’est légitime de leur donner la chance de porter leurs griefs devant une Cour supra nationale. Il s’agit, tout simplement d’une garantie de justice de plus qui ne devrait pas être vue comme une atteinte à la souveraineté des Etats ou une ingérence dans leurs affaires internes. La Cour est le fruit d’une longue bataille de la société civile africaine et internationale, la remettre en cause en ce vingt unième siècle est un grand recul pour le continent. Jeter le bébé avec l’eau du bain serait bien inconvenant pour l’Afrique.
Nouhou Madani Diallo
Greffier-Adjoint
Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples